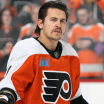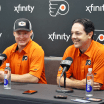MONTRÉAL - Vingt-quatre.
C'est un chiffre symbolique à Montréal pour deux raisons : c'est le nombre de titres de la Coupe Stanley remportés par les Canadiens de Montréal au cours de leur histoire de 107 ans, qui remonte à avant la naissance de la Ligue nationale de hockey, et c'est le nombre d'années qui s'est écoulé depuis leur dernière conquête en 1993.
L'épice montréalaise du paradis du hockey
La pression que les joueurs des Canadiens doivent subir a des côtés positifs et négatifs

© Francois Lacasse/Getty Images
par
Arpon Basu @ArponBasu / Directeur de la rédaction LNH.com
C'est aussi un chiffre approprié puisqu'il y a 24 heures dans une journée et c'est le temps que passe le Montréalais moyen à penser au moment où cette 25e bannière de la Coupe Stanley pourra être suspendue dans les hauteurs du Centre Bell.
C'est peut-être exagéré, mais à peine, et c'est ce qui rend la ville de Montréal si unique dans le monde du hockey professionnel.
À l'époque où il occupait le poste de directeur général des Canadiens, et après une glorieuse carrière de joueur à Montréal l'ayant conduit au Temple de la renommée, Bob Gainey avait décrit cette particularité, ce je-ne-sais-quoi comme étant une sorte « d'épice ».
Gainey a par la suite continué d'utiliser cette expression pour parler des controverses et de l'hystérie, qu'elle soit négative ou positive, qui entouraient les Canadiens et qui pouvaient influencer son rendement et celui de ses joueurs.

© B Bennett/Getty Images
Cette « épice » demeure un concept flou et elle varie d'une personne à une autre, mais c'est ce qui pimente la vie à Montréal.
En utiliser trop peut être déroutant et il n'y en a jamais pas assez, mais trouver l'équilibre parfait peut être euphorique.
« À mon avis, toutes les villes canadiennes se ressemblent, mais Montréal a sa propre saveur en raison de la présence des deux langues et de l'histoire de l'équipe », a récemment répondu Gainey quand on lui a demandé ce qu'il voulait dire par « épice », huit ans après son commentaire original. « Les partisans montréalais sont intenses et ils veulent que leur équipe joue bien. En fait, chaque jour, c'est un peu plus intense à Montréal qu'à Pittsburgh ou à Nashville. »
« On veut être capable d'en profiter et de travailler toujours sous la loupe. Si on n'aime pas ça, on peut le faire pendant un certain temps, mais à la longue, ça devient épuisant. »
Et ceux qui finissent par s'épuiser oublient ce que jouer au hockey pour les Canadiens de Montréal signifie pour tant d'autres.
Quand le défenseur des Stars de Dallas Jordie Benn a été échangé aux Canadiens, il a qualifié Montréal de « paradis du hockey » à maintes reprises. De tels propos rappellent peut-être à quelqu'un comme le gardien vedette Carey Price, qui a passé toute sa carrière de dix ans avec l'équipe, pourquoi Montréal est un endroit si spécial.
« Je ne peux pas réellement identifier ce que c'est, c'est uniquement un halo de hockey sur la ville, a déclaré Price. C'est le seul sport majeur en ville, je pense que ç'a beaucoup à voir. Le hockey fait partie de la culture à Montréal. Ç'a toujours été. »

© Minas Panagiotakis/Getty Images
Un exemple parfait de cette situation est survenu la semaine dernière quand les Canadiens se sont entraînés avant de partir affronter les Rangers à New York. Des centaines d'enfants ont profité de la semaine de relâche pour envahir leur centre d'entraînement en banlieue.
« C'est une façon un peu bizarre de le dire, mais j'ai parfois l'impression de me donner en spectacle, a révélé Price. On est toujours observés. Par exemple, aujourd'hui, plusieurs personnes sont venues nous regarder nous entraîner et pourtant, ce n'était qu'une petite séance de 30 minutes avant notre départ.
« Mais je ne le remarque même plus. »
Benn, lui, l'a remarqué. Tout comme il a constaté une différence quand il a joué son premier match devant une salle comble de 21 288 partisans déchaînés au Centre Bell le 28 février. C'était le 529e match consécutif disputé à guichets fermés, saison régulière et séries éliminatoires confondues, dans cet amphithéâtre depuis le 8 janvier 2004.
« C'était encore mieux que ce que j'espérais. Le simple fait d'enfiler ce chandail est un grand honneur », a indiqué Benn, un natif de Victoria en Colombie-Britannique, à propos de sa première partie. « C'est ce dont les enfants rêvent. Évidemment, j'étais un partisan des Canucks [de Vancouver] quand j'étais petit, mais c'est extraordinaire de jouer au Canada, à Montréal et au Centre Bell.
« À Dallas, c'est autre chose. Les partisans sont incroyables là aussi, mais quand on est au paradis du hockey à Montréal et quand les partisans scandent "Go Habs Go!", ça motive tous les gars sur le banc. C'est complètement fou. »
Jouer pour les Canadiens est encore très significatif pour beaucoup de joueurs et c'est un élément important de cette « épice ». Ce n'est pas seulement une question de pression, c'est aussi parce qu'ils participent à quelque chose de plus grand qu'eux.
« Revêtir cet uniforme est un honneur », a déclaré le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban lors d'une conférence de presse au Centre Bell le 1er mars, la veille de son premier match contre son ancienne formation. « Il n'y a pas de glace dans l'amphithéâtre en ce moment, elle est recouverte, mais on n'a pas besoin de la voir pour comprendre ce qu'il représente. Il suffit de lever les yeux pour voir les noms et les numéros. C'est son essence. C'est pour ça qu'on pratique ce sport, c'est pour l'histoire. On veut faire partie de cette histoire et on en fait partie. »
Or, avec cet honneur vient la pression, l'autre facette de cette « épice », et cette pression repose habituellement sur trois personnes en particulier, sur trois postes chez les Canadiens qui sont probablement plus névralgiques à Montréal que partout ailleurs dans le monde du hockey. Les personnes qui doivent tolérer le plus cette « épice » à Montréal sont l'entraîneur, le capitaine et le gardien de but.
L'entraîneur
Michel Therrien estime qu'il a rencontré la presse environ 250 fois par saison lorsqu'il était entraîneur des Canadiens. Ce n'était donc qu'une rencontre parmi tant d'autres.
Il a accepté de s'entretenir avec LNH.com pendant la fin de semaine du Match des étoiles à Los Angeles le 28 janvier et il était d'excellente humeur. Therrien allait diriger une équipe d'étoiles pour la première fois de sa carrière, alors que ses Canadiens étaient bien installés au sommet de la section Atlantique avec une avance de sept points.
Un peu plus de deux semaines plus tard, après une série de six défaites en huit parties au retour de la pause du Match des étoiles, son équipe occupait toujours le premier rang avec une avance de six points, mais Therrien a été congédié.

© Minas Panagiotakis/Getty Images
Au fil de cette conversation de 15 minutes, Therrien a offert un aperçu de ce que c'était de diriger les Canadiens sans jamais se plaindre.
Un an plus tôt, Therrien était à la barre d'une équipe qui a vécu une descente aux enfers historique. Les Canadiens possédaient la meilleure fiche de la LNH quand Price s'est blessé au genou le 25 novembre 2015, mais à la fin de la campagne, ils étaient exclus des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.
Therrien ne faisait pas l'unanimité avant la saison 2015-16, mais la pression à son endroit s'est considérablement accrue après une telle débandade.
Au cours des cinq années du deuxième séjour de Therrien au poste d'entraîneur des Canadiens, cette période et celle qui a précédé immédiatement son congédiement ont été les seules véritables difficultés qu'il a rencontrées. Elles apportent cependant un éclairage nouveau sur ce qu'il a déclaré à propos de sa relation avec le public montréalais pendant son passage derrière le banc des Canadiens.
« Au Québec, on a les meilleurs partisans, a-t-il lancé. Je pense que je rencontre les membres des médias 250 fois par année, en moyenne. Les gens nous voient dans leur salon tous les jours, alors il se crée une relation. Les gens s'identifient à l'entraîneur. Quand je les croise dans la rue, c'est comme si on était déjà amis. Ils ont l'impression de me connaître comme un ami.
« Mais les gens sont incroyables. Je n'ai jamais, jamais vécu de situation désagréable. Ça n'est jamais arrivé. Il faut dire que quand ça va moins bien, j'ai tendance à rester à la maison. Je ne lis pas les journaux et je ne regarde pas les nouvelles. L'an dernier, j'ai beaucoup regardé Netflix. »
Therrien en rit parce qu'il sait que ça fait partie de son métier. Pour être l'entraîneur des Canadiens, il faut savoir gérer les relations avec les médias et Therrien était un des meilleurs à ce chapitre.
Par le passé, quand l'équipe comptait sur un large contingent de joueurs francophones, l'entraîneur n'était pas le seul membre de l'organisation pouvant s'adresser à la majorité francophone de ses partisans dans sa langue. Or, ce n'est plus le cas.
Quand les Canadiens ont échangé le centre David Desharnais aux Oilers d'Edmonton contre le défenseur Brandon Davidson le 28 février, le centre Phillip Danault est devenu le seul joueur de l'équipe dont la langue maternelle est le français. Les attaquants Torrey Mitchell et Paul Byron peuvent mener des entrevues en français, mais les jours où la formation des Canadiens était constituée d'une grande proportion de joueurs francophones sont révolus.
La dernière fois que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley en 1993, il y avait 14 joueurs francophones au sein de la formation, alors les temps ont réellement changé. Dans ce contexte, l'entraîneur devient la voix de l'équipe, ce qui signifie qu'il doit savoir naviguer dans une mer de médias selon le rendement de sa troupe.
Therrien est passé maître dans cet art. Il parvenait souvent à orienter les conférences de presse d'après-match vers les sujets qu'il voulait aborder, et ce, peu importe les questions qui lui étaient posées.
« Ce qui est important dans ma relation avec les médias, c'est que j'ai fini par comprendre que la question n'est pas importante, a révélé Therrien. Ce qui compte, c'est ma réponse. Pour celui qui est dans son salon et qui regarde les nouvelles le soir, si vous voulez me faire parler d'un sujet particulier, tout ce qu'il voit, c'est ma réponse. C'est pour ça que, bien que je respecte vos questions et que j'essaie d'y répondre du mieux que je peux, si une question traite d'un élément que je ne veux pas aborder, je vais la rediriger vers un autre sujet. »
Un entraîneur de hockey est habituellement engagé parce qu'il sait comment une équipe doit jouer. Les relations avec les médias ne sont qu'une petite partie du travail. Ce n'est pas le cas à Montréal.
« Je ne sais pas comment ça se passe à Toronto, mais Montréal est un marché unique, a ajouté Therrien. Il y a des francophones et des anglophones. Ça soulève beaucoup de passion. Il ne faut pas oublier que les Québécois ont le sang latin, alors ils sont très émotifs. »
Cette dualité chez les partisans des Canadiens et les différences de perceptions de l'équipe et de ses décisions entre ces deux communautés linguistiques sont au cœur de la nature unique de Montréal comme ville de hockey.
« À Montréal, il y a deux marchés, un anglophone et un francophone, et ce sont deux marchés complètement différents, a poursuivi Therrien. C'est difficile à expliquer, mais je vais vous donner un exemple. À mon premier séjour derrière le banc des Canadiens, il y avait José Théodore, qui commençait sa carrière, et Jeff Hackett, un gardien établi. Quand je faisais jouer Jeff Hackett, les médias francophones disaient que j'avais pris la mauvaise décision, que j'aurais dû faire jouer le jeune québécois. Quand j'envoyais José Théodore dans la mêlée, j'obtenais la même réaction de l'autre côté. C'était deux marchés différents à l'époque et c'est encore comme ça aujourd'hui.
« C'est pour ça que Montréal est un marché unique. Et honnêtement, j'adore travailler dans ce marché. »
Therrien a été remplacé le 14 février par Claude Julien, qui avait été congédié par les Bruins de Boston une semaine plus tôt. C'est aussi lui qui était venu en relève à Therrien la première fois qu'il avait été remercié par les Canadiens en 2003.
Julien comprend exactement avec quoi Therrien a dû apprendre à composer parce que, comme lui, il est déjà passé par là. Et lui aussi, il adore ça.

© Minas Panagiotakis/Getty Images
« Les gens aiment leur équipe, ils sont passionnés et c'est le genre d'endroits où certains entraîneurs aiment travailler », a déclaré Julien au lendemain de son embauche. « On veut être à un endroit où il y a plus de pression parce que c'est ce qui nous motive. On ne voit pas ça comme de la pression, on voit ça comme un défi et on aime travailler dans cet environnement. Je trouve ça excitant et amusant. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais personnellement, ça me plaît. »
Or, tous ne l'apprécient pas autant que lui et c'est ce qui rend le travail d'entraîneur à Montréal si difficile pour certains. Jacques Lemaire est un de ceux-là.
Lemaire voyait toute cette attention médiatique comme un fardeau et c'est pour cette raison qu'il a préféré ses passages avec les Devils du New Jersey et le Wild du Minnesota car la pression des médias y était beaucoup moins grande. Lemaire, qui est membre du Panthéon du hockey, a eu une belle carrière de 12 saisons (1967 à 1979) avec les Canadiens, alors il connaissait l'environnement. Il a cependant eu de la difficulté à gérer cet aspect du métier au cours de ses 97 parties de saison régulière derrière le banc, soit les 17 derniers matchs de 1983-84 et toute la campagne de 1984-85. Lemaire a quitté son poste après cette saison pour se joindre à la haute direction des Canadiens jusqu'à ce qu'il retourne derrière le banc d'une équipe huit ans plus tard. Il est devenu l'entraîneur des Devils en 1993 et il a remporté la Coupe Stanley à sa deuxième année à la barre de la formation du New Jersey en 1995.
« C'est un peu différent être joueur et entraîneur [à Montréal], a affirmé Lemaire. Quand on est un joueur, les gens vous parlent de vos performances tous les jours. Que ce soit après les parties ou au restaurant avec votre femme, les gens viennent vous parler du match, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils feraient et tout ça. C'est comme ça tous les jours. C'est comme si vos partisans vous suivaient partout. On rencontre des gens partout où on va et ils ont regardé le match et ils vous ont vu jouer la veille.
« Quand on est entraîneur, c'est différent parce que c'est la presse qui fait ça. Les journalistes arrivent et disent : "Tu aurais dû faire jouer plus ce joueur." C'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on ne fait jamais la bonne chose. Quand ça revient chaque jour, c'est pénible. Si tu veux clouer un joueur au banc, tu vas entendre tous les commentaires qui vont te contredire. Le problème, ce n'est pas le fait que [les médias] donnent leur opinion, ce n'est pas ça. C'est plutôt ce que ça provoque chez le joueur et au sein de l'équipe. S'ils disent que j'ai fait une erreur en clouant un joueur sur le banc, que pensez-vous que le joueur va penser? Et il faut se battre contre ça. »
Lemaire a occupé le poste d'entraîneur pendant 15 saisons avec les Devils, le Wild, puis de nouveau avec les Devils. Pourtant, une seule a suffi pour lui à Montréal.

© Denis Brodeur/Getty Images
Le capitaine
Chris Chelios venait tout juste de représenter les États-Unis aux Jeux olympiques de Sarajevo en 1984 lorsqu'il est arrivé à Montréal, sans savoir à ce moment qu'il deviendrait le premier capitaine américain des Canadiens, cinq ans plus tard.
Il a immédiatement découvert ce que ça représentait de jouer à Montréal.
« Je n'avais jamais mis les pieds à Montréal avant d'y jouer, donc je suis venu et j'ai regardé quelques matchs parce que j'étais blessé. Le premier match que j'ai vu, les partisans ont hué Larry Robinson parce qu'il a fait une mauvaise passe donc je les ai remarqués, a dit Chelios. Je ressentais la pression initialement et j'ai connu des débuts très difficiles en raison de ça. Ça ne m'était jamais arrivé, ça ne m'avait jamais dérangé. Heureusement, nous avons fait un bon bout de chemin en séries [jusqu'en finale d'association], mes premières séries après 12 matchs [de saison régulière], j'ai pris un peu d'assurance et j'ai surmonté cette pression. »

© B Bennett/Getty Images
Pouvoir gérer cette pression est un élément essentiel lorsqu'on joue à Montréal, surtout en tant que capitaine, et c'est ce qui fait de Gainey le mieux placé pour la définir comme étant une « épice » parce qu'il a porté le « C » pendant huit saisons en plus d'occuper les postes d'entraîneur et de directeur général de la formation.
Si la pression peut provenir de sources externes comme les partisans et les médias, la majorité est enracinée dans la riche histoire de l'équipe et les rappels constants de celle-ci.
Pas moins de 24 bannières de la Coupe Stanley pendent au-dessus de votre tête chaque fois que vous jouez à domicile, sans mentionner les chandails retirés de 17 membres du Temple de la renommée, dont plusieurs viennent régulièrement assister aux matchs et discuter avec vous, vous encourageant à tout donner chaque soir.
Le capitaine doit porter le poids de tout ça parce qu'il est, à plusieurs égards, le visage de l'équipe. Il est celui qui a reçu la Coupe Stanley au nom de l'équipe sur une base régulière durant l'époque glorieuse des Canadiens, et il est celui qui doit répondre aux questions concernant les lacunes de l'équipe lorsque la première option ne se présente pas, ce qui est le cas depuis 24 ans.
Personne ne vous rencontre pour vous dire qu'on s'attend à ce que vous poursuiviez la tradition d'excellence, que vous acceptiez de porter le flambeau bien haut, comme le rappellent les paroles du poème « Dans les champs des Flandres » de John McCrae datant de la Première Guerre mondiale qui sont inscrites sur les murs du vestiaire des Canadiens.
Mais le message est compris.
« Je crois que ce qui alimente Montréal est le succès, l'histoire et la volonté de revenir au sommet », a déclaré Brian Gionta, le deuxième capitaine américain de l'histoire des Canadiens, qui a joué à Montréal entre 2009 et 2014. « Peu importe si ça provient du vestiaire ou de l'extérieur, les attentes sont toujours là.
« Vous le sentez dans l'histoire. C'est l'équipe la plus titrée des équipes originales de la ligue. Lorsque vous enfilez ce chandail, vous avez l'honneur de représenter cette équipe et cette ville. On ne vous dit rien. Vous le sentez quand vous mettez le chandail. »

© Bruce Bennett/Getty Images
C'est ce qui différencie la pression de jouer à Montréal de celle de jouer à Toronto, où les Maple Leafs ont une histoire presque aussi longue que celle des Canadiens, une présence médiatique presque identique, sinon plus importante, mais sans la tradition victorieuse.
Vincent Damphousse a amorcé sa carrière avec les Maple Leafs et y est devenu une vedette, mais c'était durant une période creuse à Toronto entre 1986 et 1991. Il est arrivé à Montréal, sa ville natale, en 1992, a gagné la Coupe Stanley à sa première saison et a été nommé capitaine en 1996, lui qui est le dernier joueur francophone à avoir porté le « C » avec les Canadiens.
Bien peu de joueurs peuvent mieux décrire la différence entre la pression de Montréal et celle de Toronto que Damphousse.

© Robert Laberge
« À Toronto, les attentes étaient toujours un peu plus basses, a-t-il expliqué. Je veux dire, l'équipe n'avait pas gagné depuis 1967 et je suis né en 1967. Donc c'est différent parce que les attentes sont tellement plus hautes à Montréal en raison du nombre de championnats qu'ils ont gagné et c'est ce à quoi tout le monde s'attend, même si ce n'est peut-être pas réaliste dans le hockey d'aujourd'hui.
« Mais j'ai toujours vu la pression comme une bonne chose. Vous regardez les meilleurs athlètes de tous les temps, ceux qui ont connu le plus de succès, et ils ont élevé leur niveau de jeu quand la pression était à son plus haut. Je ne suis pas à leur niveau, mais c'est pourquoi j'ai aimé jouer à Montréal. »
L'autre raison qui explique que l'histoire des Canadiens ajoute la pression de gagner plus que n'importe où ailleurs, c'est parce qu'elle se promène littéralement dans les corridors du Centre Bell.
Jean Béliveau, avant que sa santé ne l'empêche de le faire, était presque toujours dans le siège 1, section 102, rangée EE. Lors du premier match à domicile des Canadiens, une semaine après son décès le 2 décembre 2014, le siège de Béliveau a été laissé vide et était orné de son chandail no 4 alors qu'un projecteur l'illuminait durant tout le match. Son épouse Élise était assise sur le siège no 2, comme toujours.
C'est l'exemple parfait pour illustrer à quel point le passé des Canadiens peut influencer son présent.

© Francois Lacasse/Getty Images
Ce n'est pas seulement Béliveau qui accordait de l'importance au fait de se présenter aux matchs des Canadiens, il était seulement l'ancien joueur le plus visible et le plus important à le faire. Montréal a une salle réservée pour les anciens au niveau de la glace au Centre Bell, non loin du vestiaire des Canadiens. Le fait de croiser des légendes comme Guy Lafleur ou Yvan Cournoyer avant les matchs n'est pas rare.
Il pourrait être considéré comme un fardeau de constamment être en contact avec autant de légendes pour les joueurs actuels, établissant un standard qui est presque impossible à atteindre, mais Damphousse ne le percevait pas de cette manière.
« Je le voyais bien plus comme une motivation qu'un fardeau, a-t-il dit. Ça m'a aidé de les voir autour de l'équipe. C'était un rappel que je ne pouvais pas lâcher, que je devais performer. »
Avant le sixième match de la demi-finale de l'Association de l'Est en 2010 contre les Penguins de Pittsburgh, alors que les Canadiens tiraient de l'arrière 3-2 dans la série et qu'ils s'apprêtaient à sauter sur la glace du Centre Bell, Béliveau marchait dans le tunnel du vestiaire des Canadiens en direction de son siège placé trois rangées derrière le banc des locaux.
Celui qui se tenait le plus près de la patinoire était Glen Metropolit, un joueur de centre qui a roulé sa bosse dans la LNH et qui pivotait le quatrième trio des Canadiens, un joueur qui allait jouer durant 2:58 ce soir-là. Quand Béliveau a passé devant Metropolit, il s'est arrêté pour le motiver et ils se sont cogné le poing, un moment qui a été capté par les caméras.
Les Canadiens ont gagné ce match 4-3 avant de remporter le match ultime deux jours plus tard pour éliminer les champions en titre de la Coupe Stanley. Personne ne peut affirmer avec assurance que Béliveau a eu un impact sur la remontée de l'équipe dans cette série.
Mais ça n'a certainement pas nui.
« C'est comme une famille », a commenté Robinson, qui a joué 17 saisons à Montréal, mais aucune comme capitaine. « Pourquoi les enfants, quand ils grandissent, certains sortent des chemins pavés et se retrouvent en prison et que d'autres survivent? C'est parce que vous avez la famille, les valeurs et les bons gens pour vous montrer l'exemple.
« C'est ce que Montréal a toujours eu. »
Le capitaine actuel, Max Pacioretty, est le bénéficiaire le plus récent de ce sentiment familial, mais il est aussi celui qui doit maintenant porter le poids de la disette sans conquête de la Coupe Stanley la plus longue dans l'histoire de l'équipe.

© Michael Martin/Getty Images
« Je crois que plus souvent qu'autrement, le succès individuel est basé sur les succès de l'équipe et l'an dernier c'était ma première saison comme capitaine et nous avons trébuché, a dit Pacioretty, plus tôt cette saison. Comme joueur, je sens que je peux être jugé là-dessus et c'est normal parce que je suis le leader de cette équipe, et peut-être que ça s'est transposé un peu cette année. »
C'est de cette manière que Pacioretty perçoit son rôle de capitaine et ça illustre parfaitement la pression inhérente de ce rôle à Montréal avec en trame de fond ces nombreuses bannières de champions.
Mais il n'échangerait cela pour rien au monde.
« J'aime tellement jouer ici et le fait que je sois capitaine, ça sonne exagéré, mais qu'est-ce qui pourrait être mieux? J'ai une famille, une équipe formidable, a-t-il énuméré. Je suis le capitaine de la meilleure concession au monde. »
Le gardien
José Théodore avait une perception différente de celle de Therrien au sujet de la lutte qu'il livrait avec Jeff Hackett, mais la pression n'en était pas moins forte pour les mêmes raisons linguistiques et culturelles citées par son ancien entraîneur.
Théodore est natif de Laval, sur la rive-nord de Montréal, un gars de la place qui avait dans sa mire le poste le plus exigeant peut-être d'entre tous les sports d'équipe à l'âge de 22 ans en 1998, avec Hackett comme seul obstacle.
Quand Therrien justifiait ses décisions ayant trait aux gardiens aux médias francophones et anglophones, Théodore obtenait un préjugé favorable des médias francophones. Mais cela peut être un piège.

© Denis Brodeur/Getty Images
« Comme athlète vous devez performer, on ne s'en sort pas, a dit Théodore. Mais si vous êtes de Montréal ou francophone, peut-être obtenez-vous trop d'attention trop rapidement. J'en avais énormément après seulement 16 matchs dans la LNH, ce qui est peut-être un peu trop tôt. La même chose s'est produite pour des joueurs doués qui se sont présentés au camp d'entraînement, comme Mike Ribeiro, Guillaume Latendresse et d'autres.
« Après que je me sois établi, j'avais le sentiment d'être jugé sur mes performances, ce qui était normal. Mais oui, à mes débuts, la pression était plus forte. Pour moi par contre, c'était une pression positive. Ça me rappelait que je devais continuellement rester au sommet de ma forme. »
Théodore a relevé que le brio que les gardiens québécois Patrick Roy et Martin Brodeur ont connu à un jeune âge l'avait aidé à apprivoiser l'environnement particulier de Montréal. Depuis qu'il était tout jeune, il voulait suivre leurs traces.
En 2002, à l'âge de 25 ans, Théodore a remporté les trophées Hart, à titre de joueur par excellence de la LNH, et Vézina, comme meilleur gardien. Mais en 2006, il a connu une baisse de régime et, avec Carey Price pointant à l'horizon, il a été échangé à l'Avalanche du Colorado, comme c'était arrivé à Roy il y a un peu plus de 10 ans plus tôt.
Price a connu une ascension vers la gloire chez les Canadiens très semblable à celle de Théodore. La différence, c'était que les attentes à l'endroit de Price n'étaient pas basées sur la langue qu'il parlait, mais plutôt sur le fait que les Canadiens l'avaient choisi au cinquième rang de la séance de repêchage 2005 de la LNH.
Price avait par la suite fait augmenter le niveau d'espérance en aidant l'équipe canadienne junior à remporter la médaille d'or au Championnat du monde 2007 et les Bulldogs de Hamilton à gagner la Coupe Calder dans la Ligue américaine de hockey quelques mois plus tard.

© Andre Ringuette/Getty Images
Il s'est vu confier le poste de gardien de confiance de l'équipe deux ans après le départ de Théodore. Gainey a décrété le début de l'ère Price en échangeant Cristobal Huet, le 26 février 2008. À ce moment, Gainey avait souligné l'importance pour lui d'apprendre au plus tôt les rudiments du métier de gardien à Montréal. Ainsi, raisonnait-il, Price entrerait plus rapidement dans le vif de sa carrière, avec toute l'expérience acquise.
Le gardien natif de Anahim Lake, en Colombie-Britannique, a amorcé sa carrière sur une trajectoire ascendante, avant de stagner et de connaître un sérieux creux de vague jusqu'à ce qu'il se fasse ravir le poste de gardien numéro un par Jaroslav Halak avant les séries éliminatoires de 2010.
À l'âge de 22 ans, Price avait connu les joies et les peines associées à la position de gardien à Montréal, lui conférant amplement de temps afin de revenir plus fort, comme Gainey l'avait prédit.
Après l'échange de Halak, au terme des séries 2010, Price est redevenu le numéro un et il a gardé la mainmise sur le poste, remportant les trophées Hart et Vézina en 2015 à l'âge de 27 ans.
La principale différence entre l'expérience de Price et de Théodore, c'est le phénomène de couverture médiatique qui a pris de l'ampleur.
Dans des entretiens individuels, Price, Pacioretty et Therrien ont chacun relevé combien l'émergence des réseaux sociaux a modifié la donne à Montréal. Les générations précédentes de joueurs n'ont rien connu de semblable: les controverses ne sont que plus sensationnelles avec les clics qui remplacent les manchettes-chocs des journaux et avec les amateurs qui peuvent s'immiscer dans la vie privée de leurs favoris avec leur téléphone intelligent avec caméra intégré qu'ils ont tout le temps à portée de main.
Les joueurs doivent être plus méfiants que jamais en public, pas uniquement à Montréal mais partout ailleurs dans la LNH ainsi que dans tous les sports professionnels. Sauf qu'à Montréal, contrairement à Toronto, à Boston, à New York ou à Chicago, les Canadiens sont la seule équipe sportive professionnelle importante dans la ville. L'attention qu'ils reçoivent est donc intensément portée sur eux.
« Je suis arrivé au moment de la naissance des réseaux sociaux, a dit Price. Ç'a totalement modifié le portrait. Des événements qui passaient auparavant sous le radar sont maintenant dévoilés publiquement. Les opinions n'étaient pas si largement diffusées. Toutes les tribunes et les plates-formes que les gens utilisent n'étaient pas disponibles auparavant. »
C'est tout ce que Price n'ait jamais connu puisqu'il a grandi au sein de l'organisation du Tricolore. Il a montré une capacité à prospérer dans cet environnement parce que, ultimement, c'est un environnement qui incite les joueurs au dépassement de soi.
« C'est super de se rendre à l'amphithéâtre en sachant que ce sera plein. C'est une belle source de motivation de savoir que les gens sont derrière vous continuellement, a dit Price. Le revers de la médaille, c'est que vous aimeriez parfois aller au parc avec votre enfant et être un parent comme les autres. C'est quelque peu différent à ce chapitre.
« Mais vous sentez l'appui indéfectible des gens quand vous avez du succès. »
Après avoir été échangé, Théodore a disputé huit saisons dans les uniformes de l'Avalanche, des Capitals de Washington, du Wild du Minnesota et des Panthers de la Floride. Partout où il est passé, il a aspiré à retrouver les poussées d'adrénaline qu'il ressentait quand il jouait à Montréal. Même s'il estimait qu'il avait dû composer avec une forte pression très tôt dans sa carrière, ça lui a manqué après son départ.
« Mon meilleur conseil, c'est de savourer pleinement le moment parce que vous ne jouerez pas à Montréal jusqu'à l'âge de 50 ans, a souligné Théodore. Vous devez avoir la couenne dure pour jouer à Montréal et si c'est le cas ça signifie que vous acceptez la pression. Montréal c'est donc parfait pour vous. Ça vous pousse au dépassement.
« J'ai trouvé ça difficile par moments quand j'ai joué en Floride et même à Denver, qui est une bonne ville de hockey. À Montréal, c'est comme si vous jouiez dans la NFL parce que tous les matchs ont un 'buzz' particulier. Quand vous jouez ailleurs et que vous vous nourrissez de cette pression, c'est quasiment plus difficile d'être prêt.
« Donc oui, la pression est plus forte à Montréal, mais j'avais besoin de cette pression afin d'être à mon mieux. Je crois honnêtement que je ne serais pas devenu le gardien que j'ai été si je n'avais pas commencé ma carrière à Montréal. »
Price a déjà dit la même chose en parlant de son début de carrière à Montréal, plus particulièrement aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.
Price ne s'était jamais retrouvé sur une grande scène du genre sur le plan international et même dans la LNH. Il a sereinement guidé le Canada vers la conquête de la médaille d'or parce qu'il s'était endurci au même type de pression à Montréal.
Au bout du compte, c'est peut-être ça l'épice de Montréal comme ville de hockey. Peut-être est-ce une forme de mécanisme afin de s'assurer que seuls les plus forts psychologiquement, les plus féroces compétiteurs, les plus affamés d'entre tous, parviennent à faire leur marque à Montréal, presque comme une forme de sélection naturelle.
Ça n'a pas fourni de résultats probants dernièrement, mais le fruit de tout ça est bien en évidence à tous les matchs à domicile au plafond du Centre Bell, avec 24 bannières de championnat de suspendues, qui attendent impatiemment l'arrivée d'une nouvelle.
« Ce qui a rendu Montréal spéciale, a souligné Robinson, c'est qu'elle peut vous élever au statut de superhéros ou encore vous casser. »